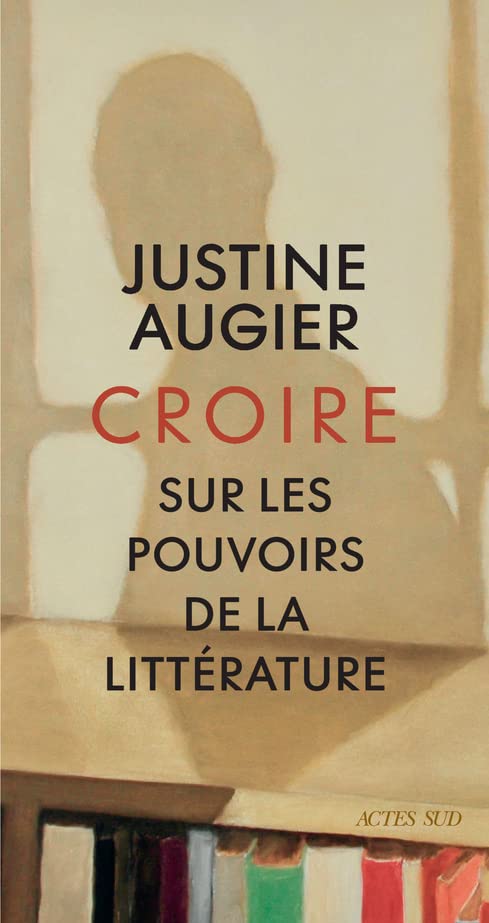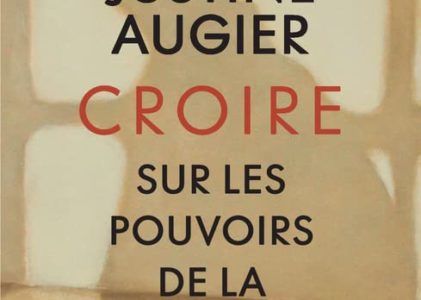Ceci n’est pas une note de lecture mais un écho personnel à la lecture du livre de Justine Augier Croire. Sur les pouvoirs de la littérature. Ce récit est pudique, amplifié par les ondes de la maladie et des souvenirs. J’invite à le lire car il nous ramène à nos oublis.
Ce récit commence par nous rappeler à nos propres lectures, aux découvertes conseillées et impromptues. Comme celle de Christian Bobin qui vient de nous quitter. J’avais peut-être quinze ans. Maman avait acheté Le Très-Bas qui raconte la vie de François d’Assise dont elle m’avait offert le prénom à la naissance. Mais je n’avais pas accroché. Je n’y comprenais rien. C’est que j’aimais la logique. Mais avec Le huitième jour de la semaine, sa prose poétique m’a emmené dans des territoires inconnus. J’étais à la fois emporté et perdu, subjugué, étourdi par le rouleau de la littérature et laissé haletant sur la grève, vidé et grimaçant, essoré et grandi.
C’est l’histoire d’un deuil et d’une réconciliation tissés de silences. Les silences d’une mère pourtant portée par un élan, une confiance en la possibilité du changement de deux ou trois choses infimes ou immenses (p.38-39). Les silences décrits par Marcel Proust ou Nathalie Sarraute (p.108). Les silences de la lecture qui fait surgir au lieu d’éloigner, ces souvenirs qui remontent à la surface dans ce récit arraché au silence comme un sillon étroit sur lequel tenir et avancer, ne jamais cesser d’avancer (p.35). Les silences pesants et les silences soulagés.
C’est que nous subissons une malédiction auquel Justine Augier rnous invite à faire face. Celle du je sais qui tu es, d’identités figées, fantasmées, sculptées dans le marbre de nos fantasmes. Elle évite la facilité de renvoyer la responsabilité à quelques uns. Etre la fille d’une femme engagée en politique, c’est se retrouver à subir un préjugé assez particulier mais qui ressemble à tous les autres : je sais qui tu es. A en avoir peur. Alors, pour se sentir libre, on cherche à fuir, à s’éloigner, à se braquer. On quitte son pays. On refuse et on érige l’autre dans sa différence. Je n’avais sans doute pas fait attention au lien entre mon départ en Inde à 18 ans et la fuite du charisme parental ? Ah ! Tu es le fils de M. et M. ? Dans cette petite ville de province, je me heurtais à ce mur. Je ne le refusais pas mais était assigné à cette condition. Enfouissant dans un abîme ce que je suis et ce que je pouvait être. Bâtissant un « fort » intérieur autour de désirs inassumés.
Je me cogne encore aujourd’hui et autrement au mur du je sais qui tu es. Homme cisgenre, blanc et hétérosexuel, ayant étudié à Sciences Po Grenoble. Et pourtant, qui sais qui je suis, ce que je porte et ce que je vis, ce que je dis et ce que je tais ? Quelle identité m’est assignée ? Mais comment s’en défaire sans nier les rapports de domination qui nous habitent et nous abîment ? La tentation est grande de se sentir à part, déjà libre, comme s’il n’y avait pas de structures abrutissantes et étriquées étouffant nos corps et nos actes. Comment tenir ces deux bouts du mat qui s’étend entre nos vies singulières et nos vécus inégalitaires ?
Face à ce qui sait sans écouter, face aux identités bombardées, face à la violence qui torture en Syrie et dans le Donbass, face au mal, que faire ? Justine Augier répond par une espèce de miracle. Par les lumières de Razan, de Yassin, de Marielle. Quand des êtres singuliers font irruption dans le monde, le lendemain n’est plus comme la veille. C’est dans cette « cour des miracles des révolutions, des démocraties et des intelligences vaincues » [Victor Serge], dans cet espace de littérature où les mots ont un sens et le politique une grandeur qu’on a envie d’habiter. Et nulle part ailleurs.